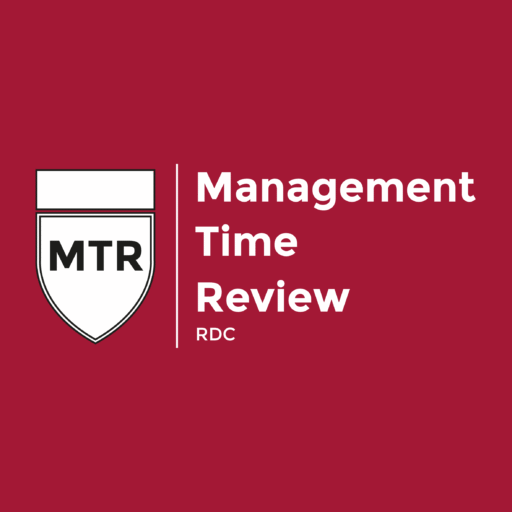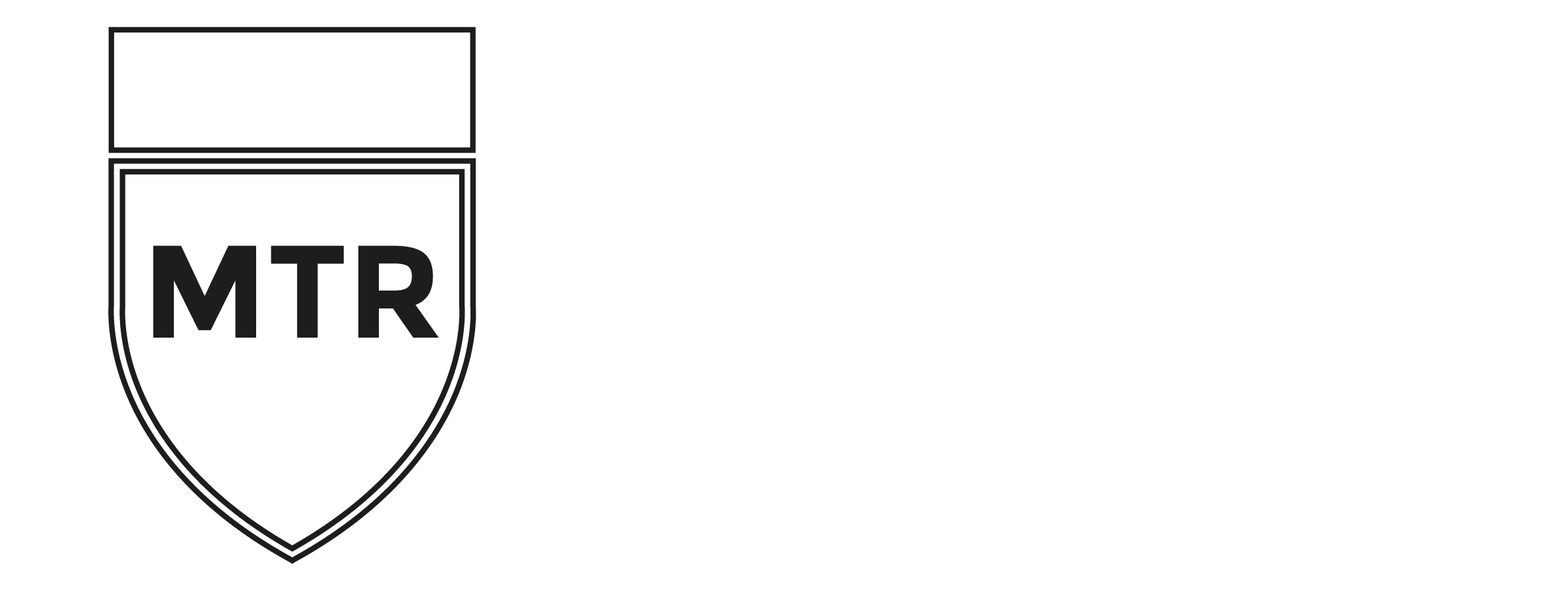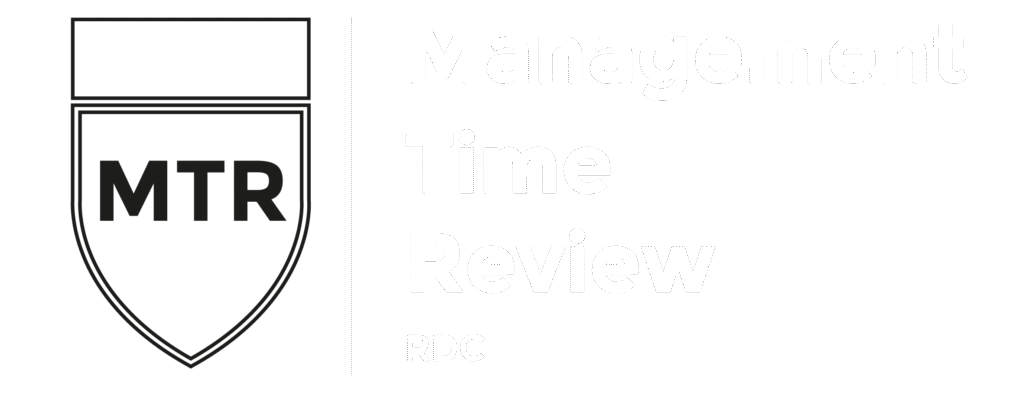Dans la salle de réunion d’une grande banque de Kinshasa, tout le monde se tait lorsque Nadine prend la parole. Son ton est posé, son analyse précise. Pourtant, elle le sait : chaque décision qu’elle annonce est scrutée avec une attention particulière. « Je dois prouver deux fois plus que mes collègues masculins que je mérite ce poste », confie-t-elle. Son expérience illustre une réalité que les chercheurs observent depuis des années : l’ascension des femmes dans les rôles de direction progresse, mais les préjugés culturels persistent.
La psychologue américaine Alice Eagly, pionnière de l’étude des stéréotypes de genre, a mis en évidence dès 2002, avec Steven Karau, la Role Congruity Theory¹. Selon cette théorie, les femmes leaders subissent une double pénalité : d’une part, leur rôle de dirigeante est jugé « incongru » avec les qualités traditionnellement attendues d’une femme, comme l’empathie ou la conciliation ; d’autre part, lorsqu’elles adoptent des comportements perçus comme nécessaires au leadership (autorité, assertivité, décision rapide), elles sont évaluées plus sévèrement que leurs homologues masculins.
Ces préjugés ont des racines profondes en Afrique. Historiquement, les postes de pouvoir, qu’ils soient politiques, militaires ou communautaires, ont été occupés par des hommes, transmettant l’idée que l’autorité est masculine. Les normes sociales et culturelles continuent de renforcer ces attentes : les hommes sont socialisés pour être assertifs et orientés vers le pouvoir, tandis que les femmes sont valorisées pour leur sens de la famille, de la communauté et de la coopération. Les influences religieuses, les mythes fondateurs et les médias locaux ont également contribué à naturaliser le pouvoir masculin, en rendant les femmes dirigeantes moins visibles et en limitant les modèles de rôle féminins.
L’acceptation d’une cheffe dépend également de la culture organisationnelle et nationale. Les dimensions de Hofstede offrent un éclairage utile. En RDC, le hiérarchisme élevé favorise l’autorité traditionnelle et rend parfois difficile l’acceptation d’un leadership féminin perçu comme « atypique ». L’individualisme relativement faible valorise les relations de groupe, ce qui peut soutenir des styles de leadership collaboratif, mais aussi renforcer les réseaux masculins établis. L’aversion à l’incertitude élevée signifie que les équipes peuvent être réticentes aux changements de style ou à la rupture avec les normes traditionnelles, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur les femmes leaders.
Malgré ces obstacles, des chiffres récents montrent des progrès encourageants. Au gouvernement central congolais, les femmes occupent désormais 17 des 53 postes ministériels, soit environ 32 % (xtrafrica.com). Dans le secteur formel privé, une étude menée auprès de 277 entreprises affiliées à la FEC révèle que 20,5 % des dirigeants sont des femmes (deboutcongolaises.org). Ces données montrent que, même minoritaire, le leadership féminin prend progressivement sa place dans des espaces traditionnellement masculins.
L’acceptation progresse également au niveau des équipes. Une enquête européenne menée par l’European Working Conditions Survey montre que la satisfaction des collaborateurs ne dépend pas du sexe du manager mais de sa capacité à impliquer et à faire grandir ses équipes. Autrement dit, quand la performance et le style de management priment, les préjugés s’effacent. Dans plusieurs entreprises interrogées, les salariés déclarent même apprécier davantage les dirigeantes qui favorisent la collaboration et la communication.
Ces résultats se vérifient sur le terrain congolais, où les femmes investissent peu à peu les postes de direction dans plusieurs secteurs dont la finance, les télécommunications, dans les mines et l’administration publique. Les freins demeurent : remarques sexistes, doutes implicites, lenteur des promotions. Mais le mouvement est lancé, porté par des figures visibles et des politiques de diversité qui changent progressivement les mentalités. « À la fin, ce qui compte, ce sont les résultats, pas le genre », résume un cadre masculin d’une société minière.
Alors, les hommes sont-ils prêts ? Pas partout, pas toujours. Mais chaque succès de dirigeante contribue à normaliser l’idée qu’un bon leader n’a pas de sexe. À mesure que les organisations valorisent la compétence, la transparence et la diversité, la question elle-même pourrait bientôt paraître dépassée.
¹ Role Congruity Theory : théorie développée par Alice Eagly et Steven Karau (2002) selon laquelle les femmes leaders subissent une double pénalité. Leur rôle est jugé « incongru » avec les qualités attendues d’une femme, et lorsqu’elles adoptent un style assertif, elles sont évaluées plus sévèrement que leurs homologues masculins.